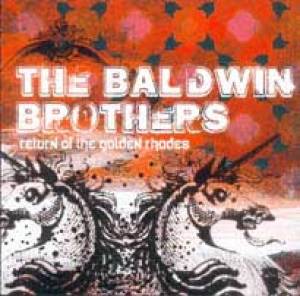RESET, c’est revenir sur ses pas. Signer un nouveau départ. Voilà trois ans qu’à l’exception de quelque Sonic Youth et autres, la programmation des Halles de Schaerbeek laisse perplexe. Récemment passée dans les mains de Marc Jacobs (Recyclart), la renaissance est espérée pour ce printemps 2007. Pas étonnant de trouver ainsi à l’affiche du RESET Festival, une programmation percutante, à l’image de la métamorphose tant attendue.
La salle s’emplit rapidement, malgré les débuts hésitants et chaotiques de The Eternals, dont la molle performance disco-punk fait regretter la fraîcheur et l’efficacité du disque ; regards sceptiques et déçus sont échangés, avec plus ou moins de discrétion chez ceux qui huent sans réserve une prestation ne décollant guère.
Encore à froid, l’entrée gargantuesque de Detroit Grand Pubahs tombe comme un cheveu dans la soupe. L’allure bûcheronne de « Paris The Black Fu » et l’imprévisible bouillonnement de funk, techno, cabaret et dark dancefloor fait sourire. Musique hybride déversée sans complexe par quatre énergumènes en perruque ou masqués. Les réserves tombent, on rit sous cape. L’effort de mise en scène est apprécié ; mais, l’effet de surprise dépassé, l’assemblage difforme n’augure rien de bien convainquant. Las, on aspire à un son plus entier, engagé dans des formes obtuses et entêtées plutôt qu’éclectiques et essayistes.
Le Dieu rockeur a entendu nos prières ; l’entrée de Dj Rob Hall canalise d’emblée les énergies dispersées, et quelques beats simples et efficaces suffisent à l’engouement. C’est puissant, inattendu de la part d’un nom discret et feutré, souvent aperçu en tournée à l’ombre d’Autechre –en compagnie duquel il a par ailleurs fondé le label ‘Skam’. Rob Hall, en DJ old-school et acid, fait évoluer sans heurts un set volontaire et charismatique. Impossible de résister à ces beats bruts et dansants ; et la moitié de Skam démontre qu’il peut aussi exceller dans la promotion d’une électronique basique exempte de tortueuses bizarreries.
Parfaite dépense d’énergie pour accueillir, temporairement exténués, l’électronica déconstruite d’Autechre (Warp). La salle est à fleur de peau, les yeux brillants et toute en sueur ; il en faut peu pour tomber dans la jouissance lorsque s’élève une première nappe délicieusement psychédélique. Beaucoup sont venus avant tout pour plonger dans cette étrange expérience musicale toujours en quête du décalage, de l'accident, du choc sonore saisi au creux d’un savant calcul mathématique. Plus conciliant que d’habitude, c’est, à l’exception de quelques reliefs ingrats, un set accessible même pour les néophytes ; presque fluide, et en tout cas dansant. Inattendu de la part d’un groupe pour qui les prestations live ne sont pas toujours l’idéale mise en valeur d’un son déconstruit. Si Autechre est passé maître dans l’art de s’échapper à mille lieues de l’album pour un live imprévisible -parfois difficile à pénétrer-, la formation a néanmoins réussi la gageure de captiver sans jamais s’enraciner. Ultra expérimentale, cette électro en mode free-jazz nous offre un moment hors du temps, nichée au creux de ces aléatoires sonores, tantôt indigestes tantôt transcendés de crescendos jouissifs. Jamais indemnes, les fans tombent, en transe, dans une nouvelle addiction.
Après telle émotion, l’ambiance ne peut en aucun cas retomber, et, aussi instantanément que s’évanouit l’univers tortueux et fascinant d’Autechre, on perçoit les premiers beats du brillant James Holden. Véritable génie, inclassable, avant-gardiste, le jeune Anglais n’hésite pas à rapprocher acid house, techno, trance et électro. Reconnu pour ses nombreuses collaborations, en signant notamment sur son propre label (Border Community) les Nathan Fake, Petter, The MFA et Lazy fat people, il se pose en figure incontournable pour un festival électro qui se veut varié, prometteur et explosif. James Holden étonne par ses beats inattendus, mais toujours sophistiqués et livrés avec franchise. On savoure tant les morceaux glissant directement vers le dance-floor, que les plus introspectifs dans la lignée de Boards of Canada. Oui, l’électro expérimentale fait encore danser.
Le set s’achève sur une poussée d’adrénaline, et, sans avoir le temps de figer son enthousiasme, Dj Darko –renommé pour ses Statik Dancing au Recyclart– lance un set rapidement sur les rails, malgré un public qui s’effiloche. Pas de regrets, et l’envie d’appuyer à nouveau sur la touche RESET. Rendez-vous à la seconde édition, prévue fin avril.
Organisation : Vaartkapoen Bruxelles en collaboration avec les Halles de Schaarbeek





 Nederlands
Nederlands  Français
Français