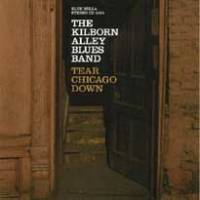Je vous confesse volontiers la réticence ressentie, lorsque ce double disque en main, je me suis dirigé vers mon lecteur CD pour découvrir les nouvelles frasques de l’auteur de « Suzette ». Car Danny Brillant incarne de prime abord et même trop bien le brave chanteur sympa pour ménagères ; celui qui traîne sa belle gueule cassée par les déceptions, mais toujours prête à aimer, car y’a pas plus beau, que l’amour évidemment… (Souvenez-vous : ‘Quand je vois tes yeux, je suis amoureux, etc…’)
Puis, en y regardant de plus près, j’ai relevé une première circonstance atténuante : l’apparition du chanteur d’origine tunisienne dans « Changement d’adresse », l’excellent film d’Emmanuel Mouret (un des seuls réalisateurs français actuels capable de rivaliser avec Truffaut ou Rohmer), sorti en 2006. Il y interprète un séducteur un brin casse- pieds, viril, trop frimeur pour inquiéter le personnage principal, au nez et à la barbe duquel il dérobe pourtant la belle proie docile, qui finit par succomber à ses charmes. Car Danny Brillant, c’est un peu ça : à première vue trop aimant pour être aimé, trop cliché pour être suspecté d’un quelconque intérêt, on n’y fait plus attention au bout d’un moment.
Et pourtant, ce double disque constitue une très bonne surprise. D’abord, le concept : un disque à danser doublé d’un Dvd pour apprendre, mouvement par mouvement, le tango, le rock et le mambo. L’idée paraît simple, il fallait pourtant y penser.
Le CD reprend une série de tubes tirés de la meilleure variété internationale (Gilbert Bécaud, Dalida, Elvis Presley, Charles Aznavour, Frank Sinatra,…), arrangés dans des versions jazzy ou latino selon les besoins, convaincantes et ainsi parées pour être dansées jusqu’à plus soif. Sur le DVD, un professeur, et parfois Danny lui-même, nous enseignent ces danses célébrant le couple et témoignent de ses états possibles : la passion, avec la part de violence qu’elle libère (le tango) ou encore la fuite et la révolte contre l’autorité (le rock). Il faut voir Danny parler de l’origine de ces rythmes et de l’émerveillement qu’il éprouve face à ceux-ci pour comprendre, s’il le fallait encore, qu’il est ici question de vraie passion et de volonté de la faire partager. Le chanteur pour dames se dévoile sous son véritable jour : honnête et touchant. Aussi bien lorsqu’il chante ou danse, que lorsqu’il évoque le couple et la rencontre, ce dont il nous a finalement toujours parlé.
En concert le 31 mai à Forest National
MSN:
http://sib1.od2.com/common/product/Product.aspx?shop=40&associd=4&catno=OD2DI6144316
I-tunes:
http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewAlbum?id=251307699&s=143446





 Nederlands
Nederlands  Français
Français